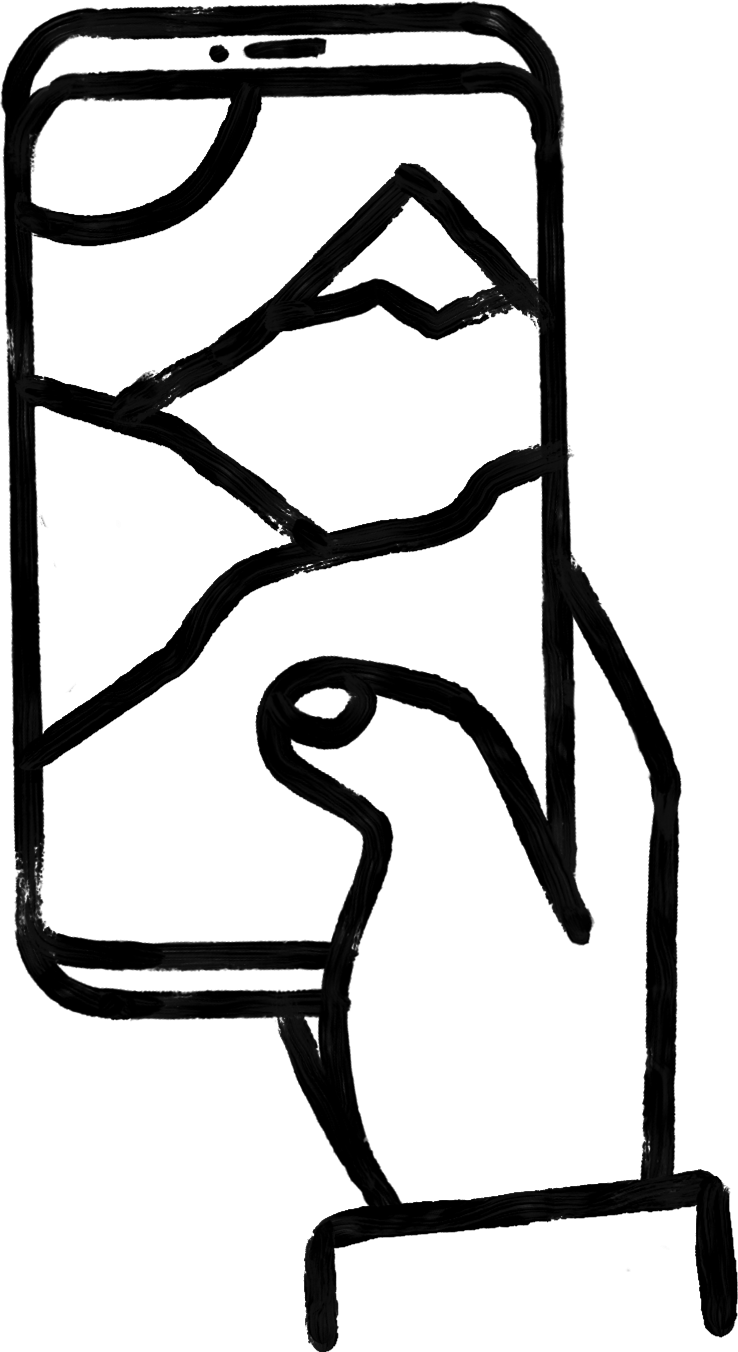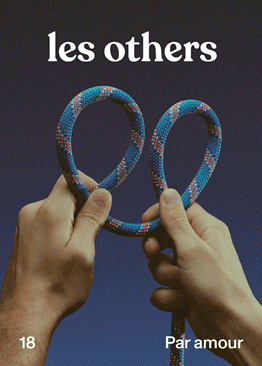L’an dernier, j’ai voulu courir mon premier ultra-trail. 100 km, hors course, sans dossard. Un itinéraire libre, en autonomie. Une aventure à travers les Alpes qui m’a particulièrement marqué. Pourtant, après cette aventure, j’ai peu couru. Baisse de régime. Perte de motivation. Je crois avoir été pris à mon propre piège. Celui d’avoir transformé un projet personnel en compétition. Celui de réduire une pratique libre, émancipatrice, en un challenge à atteindre… et d’avoir besoin d’un objectif pour apprécier la pratique. C’est tout le paradoxe.
Dans notre dernier magazine (“Hors-Jeu”), nous posions une question volontairement naïve : peut-on encore simplement jouer dehors ? Derrière cette formule se cache une vraie inquiétude : et si la pratique de plein air n’était plus tout à fait libre ? Nos loisirs sont-ils en train de perdre en innocence, pour devenir plus normés, plus compétitifs, plus intéressés ?
La course à pied, et le trail-running en particulier, cristallisent cette tension : entre l’instinctif et le stratégique, le libre et le codé, le plaisir et la performance. Et c’est d’autant plus frappant lorsque l’on prend un peu de recul : à ses débuts, le running était considéré comme une pratique aussi farfelue qu’émancipatrice, un vœu de liberté individuelle, sans règle. Un début d’âge d’or qui sent bon les années 70.
Cet été, entre courses mythiques et sorties improvisées, entre records et pauses contemplatives, nous avons donc posé la question : court-on encore pour soi ou seulement pour la performance ?
La dictature douce de la performance
Lorsque l’on évoque cette incitation à la performance, les coupables sont souvent les mêmes : la data, les réseaux. Strava, Garmin, les montres connectées. Autant d’outils pensés pour motiver, qui deviennent parfois les complices d’une compétition à distance. On court seul, mais on n’est jamais vraiment seul. Le segment nous provoque. Le graphique nous juge. Le feed nous flique. Récemment, le phénomène caricatural des Strava Jockeys a d’ailleurs cristallisé ce malaise collectif autour de la performance et du paraître, en contradiction avec les valeurs idéalisées du running. On aurait tort de ne regarder que du côté des GAFA pour pointer du doigts ce dévoiement de l’esprit originel du running. On assiste en fait à un changement culturel global où la pratique amateure s’imbrique à la compétition.
Dans une interview pour la newsletter Siège Arrière, le sociologue Olivier Bessy, spécialiste de la course à pied, livre un constat clair : « Il y a de plus en plus de gens qui, une fois devenus coureurs, franchissent rapidement le pas de la course officielle. Autrement dit : le temps entre le moment où je deviens joggeur et celui où je prends un dossard a diminué. Ça, c’est la première observation. La seconde, c’est que les gens s’inscrivent de plus en plus à des courses. Avant, en moyenne, on prenait 3, 4 dossards par an. Maintenant, on est à 6, 7 ou 8. ». Un appétit global des pratiquants pour le dossard et la course chronométrée, encadrée, « domestiquée », c’est son terme.
Pour expliquer ce phénomène, Olivier Bessy définit « l’illimitisme », ou la recherche constante du dépassement de soi. Une envie d’explorer ses limites, bien alimentée par les mantras type « everything is possible » chers aux équipementiers, et qui parle en particulier aux plus aisés. Une recherche de performance qui applique des réflexes professionnels à la sphère du loisir.
Le plaisir a-t-il besoin d’une excuse ?
Au risque, parfois, de confondre motivation et obligation. On s’inscrit à une course pour s’entraîner. On s’entraîne pour réussir sa course. On déshabille le loisir pour habiller la performance. De fait, dans une pratique qui valorise le résultat, le plaisir est presque devenu suspect. On maquille son allure du dimanche en « zone 2 », « endurance fondamentale », voire même “sortie avec X” (j’ai été ce X, je connais). On a besoin d’un argument scientifique ou d’un coupable pour déculpabiliser une sortie qui fait rougir ses statistiques. Courir lentement, sans but, sans montre, devient alors un acte original, marginal.
Et il y a ce nouveau paradoxe du running. D’un sport individuel, on est entré dans l’ère du collectif, cristallisé par l’essor des « runs clubs ». Le running devient donc collectif, ouvert, et convivial ? Oui, et nombreux sont les collectifs à promouvoir l’ouverture et l’inclusivité. Mais comme dans toute société, il apporte aussi le regard de l’autre, l’importance de se fondre dans un ensemble, et donc de normer sa pratique. On ne court plus que pour soi, on court aussi pour répondre aux normes implicites du groupe.
Au risque de l’exclusion : c’est une menace intégrée depuis l’enfance. L’Équipe pose cette question fondamentale : « Doit-on continuer à pratiquer un sport si on est nul ? ». C’est là l’issue de notre sujet : en tant que coureur “médiocre”, si l’on ne court que pour la performance, alors rien de sert de courir. Il faut partir, point.
Et si la performance n’était pas l’ennemi ?
Alors, faut-il renoncer à la performance ? Non. Mais peut-être faut-il la remodeler.
Pour un athlète, l’accomplissement de soi est indissociable de la performance. Théo Detienne le dit avec candeur et franchise quand il explique, en parlant de sa récente victoire sur le Marathon du Mont-Blanc «dans la dernière descente, je suis persuadé que sans la compétition et le dossard, si j’y vais à l’entrainement dans 2 semaines, reposé, j’irai pas plus vite car c’est le résultat qui fait se dépasser».
Pour un amateur, cette recherche de performance est aussi un moyen permettant de “vivre plus intensément” sa pratique. C’est un outil de connaissance de soi, un révélateur, ou parfois plus simplement, un divertissement ludique. Je me reconnais très bien ici : je sais que je ne performerai jamais vraiment. Mais à mon humble (médiocre ?) niveau, le défi sportif m’apporte un surplus de motivation, une excitation joviale, un brin de stress qui donne un supplément d’âme à la pratique. Et un sentiment d’accomplissement une fois la ligne d’arrivée franchie.
Pour en revenir aux athlètes, eux-mêmes sont au cœur de ce tiraillement. Parce qu’avant d’être un métier, c’est une passion. Nombreux sont ceux qui oscillent entre le cadre compétitif et tout ce qu’il impose, et une pratique plus libre et personnelle. Sans dossard, mais pas toujours sans objectif. Des figures comme François d’Haene, Camille Bruyas ou Kilian Jornet nous montrent une voie alternative : courir fort, mais avec un sens qui leur est propre. Ils courent des “off”, sur des tracés réalisés par leur soin. Ils créent leur propre défi. Pour explorer, pour s’explorer.
On peut alors imaginer, à l’inverse, que la performance est seulement un moyen et non pas une fin en soi. Comme un musicien fait ses gammes, ou un alpiniste s’acclimate. Un moyen d’aller plus loin, d’élargir l’horizon de sa pratique, ou de se donner la possibilité de nouvelles découvertes. C’est précisément ce que revendiquent de nombreux adeptes de trails, rebutés par le dossard. Comme le dit Hugo Betelu à travers son projet Viva Verdon « On achète son dossard (trop cher), on vient courir (trop vite) et on repart (trop loin) ». Il défend une pratique sensible, consciente, plus ancrée dans la découverte des territoires traversés, mais toujours ambitieuse.
C’est ce que l’on souhaite aux passionnés : que la ligne d’arrivée ne soit, finalement, qu’une porte ouverte vers une exploration libre, à petites foulées.
Cette réflexion s’inscrit dans la continuité d’une série de conférences et de tables-rondes « D’autres chemins », organisées à Chamonix avec i-run.fr .
INSTAGRAM — Rejoignez la plus grande communauté de nouveaux aventuriers