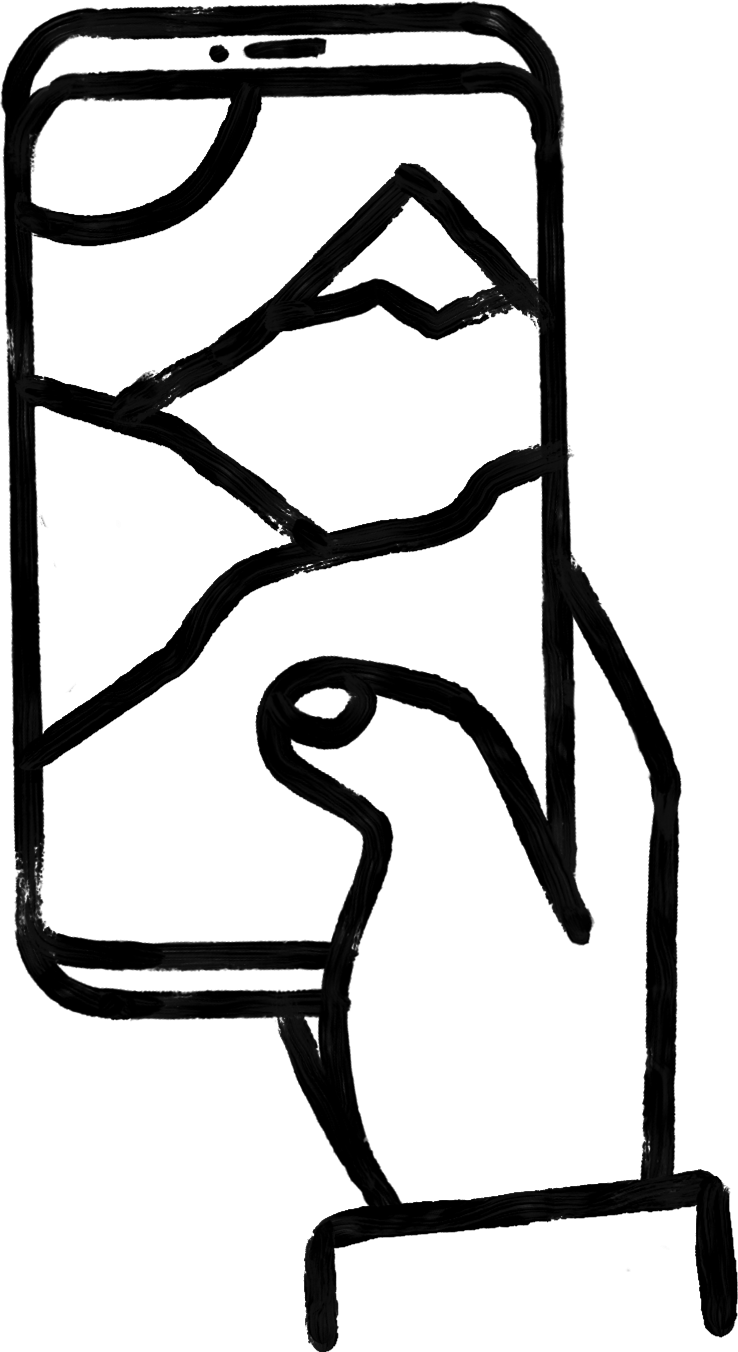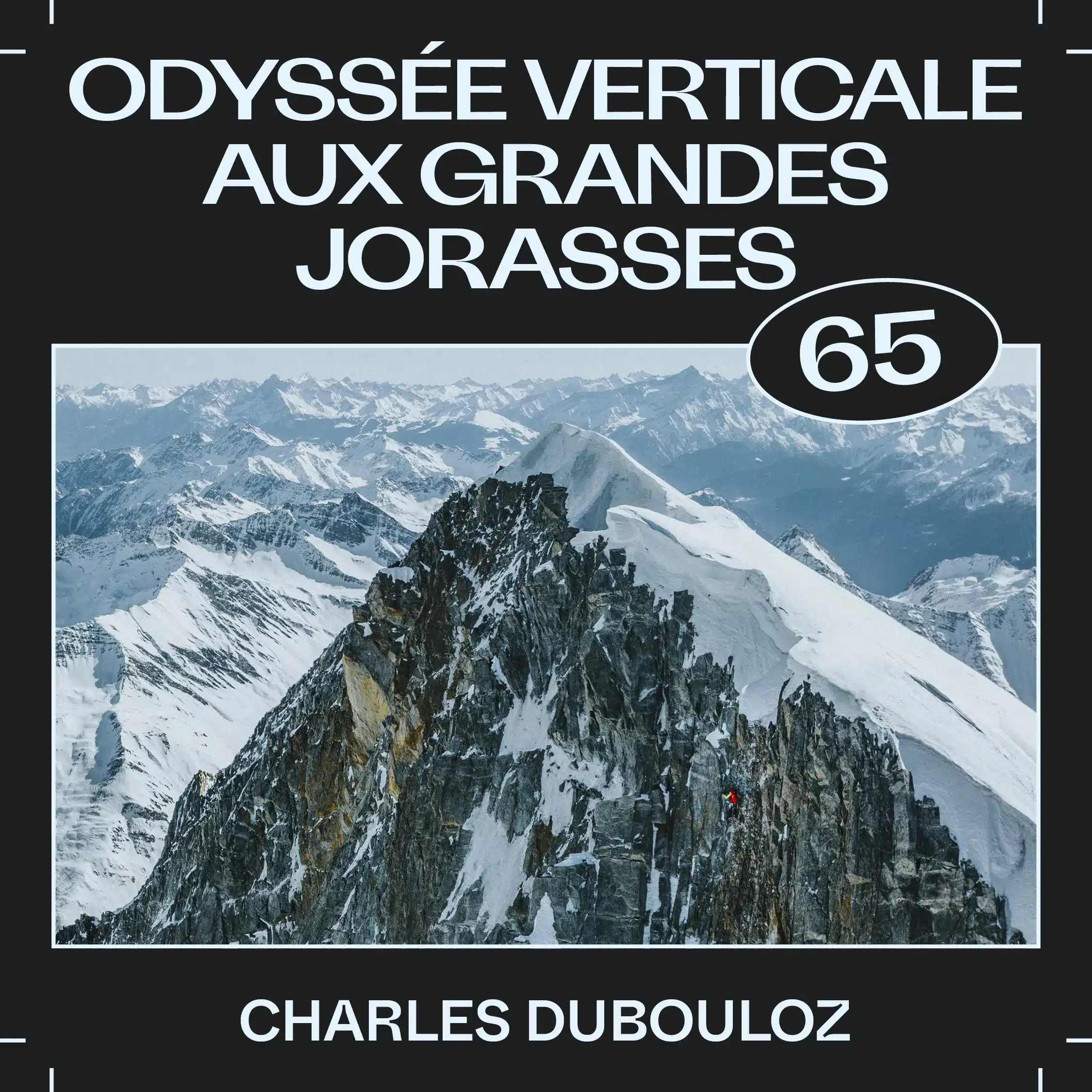Rencontre avec un irréductible amoureux de la photographie. Interview extraite de Les Others Magazine Volume II : The Hidden Issue.
[dropcap]L[/dropcap]e monde de l’Art ne serait rien sans ses coulisses, à l’abri desquels des professionnels travaillent sans relâche pour rendre chaque projet techniquement parfait. À l’image de la lumière ou du sound design au cinéma, le développement et le tirage photo argentique font partie de ces métiers de l’ombre dont on irait jusqu’à oublier qu’ils existent, persuadés peut-être qu’un automate se charge de révéler en une fraction de seconde nos si précieux clichés. Pourtant, enfermés des heures durant dans leur chambre noire, les “tireurs” déroulent, baignent, pincent, appliquent et chronomètrent, pour qu’enfin l’imaginé sur pellicule devienne réalité sur papier.
Nous avons rencontré Fred Goyeau, tireur noir et blanc, dans son laboratoire du sud de Paris. Il nous a raconté son expérience au contact des plus grands, décrit son profond amour pour une profession en difficulté et exposé son regard averti sur la photographie d’aujourd’hui.
Quel a été ton premier contact avec la photographie ?
Tout part de mon père. Il a toujours fait de la photo et je ne l’ai jamais vu sans ses appareils, que je garde encore précieusement aujourd’hui. Je devais avoir 12 ans quand on a commencé à s’organiser des sessions de développement et de tirage dans la salle de bain familiale. Mon approche de la photographie s’est donc faite directement par le laboratoire. Bien sûr, je faisais de la photo en parallèle et j’avais toujours un appareil sur moi, mais c’était moins mon truc.
Quand as-tu su que tu deviendrais tireur photo ?
Pendant mon CAP, j’ai eu l’occasion de travailler deux années de suite chez Picto, l’un des plus vieux laboratoires photographiques de Paris. En tant qu’apprenti, on ne touchait pas au développement, département “chasse gardée” réservé aux employés expérimentés. J’ai donc fait une année de tirage noir et blanc et une année de tirage couleur. J’ai eu le déclic à ce moment-là.
Après quelques mois à l’étranger et un passage à l’armée, j’ai finalement été engagé, au développement cette fois-ci. À cette époque, Picto était la plaque tournante des bons photographes. On était au contact des plus grands : Henri Cartier-Bresson, Josef Koudelka, Jacques Olivar, les frères Turnley… Parfois, c’est à toi de juger, s’il faut éclaircir d’un quart, d’un tiers ou d’un demi-diaphragme par exemple. Ça affûte vraiment ton œil, dans la lecture des positifs comme des négatifs. C’est dans une chambre noire que tu comprends comment exposer un film et à quoi ça sert.
Après deux ans et demi de développement acharné, j’avais besoin de changer d’air. J’ai monté un projet avec un ami pour partir shooter en Australie. On devait y passer un an, faire le tour du pays et revenir avec un reportage : “L’Australien et son environnement”. Un portrait, un paysage. Malheureusement, au bout de quatre mois de voyage, on a eu un accident de voiture et je suis revenu en France. Je n’étais pas dans une grande forme. Madame Gassmann, la DRH de Picto, qui avait entendu parler de l’histoire, m’a rappelé en me disant : “Fred, il faut revenir travailler, d’accord ?” Donc j’ai rempilé. Après quelques temps, j’ai profité d’un départ pour enfin commencer le tirage noir et blanc.
Pourquoi cette attirance particulière pour le noir et blanc ?
En plus d’une vraie sensibilité, il y a à cela une raison technique. Le tirage couleur nécessite de passer par une machine. Personnellement, je préfère tout faire moi-même, les mains dans la chimie du début à la fin. Quand on y pense, tout le monde peut développer du noir et blanc et c’est aussi ce qui le rend attachant. Tant que tu maîtrises bien ta lumière et que tu respectes la température des bains, tu peux faire ça dans l’évier de ta cuisine.
Ta rencontre avec Sebastião Salgado, grand photographe noir et blanc, était d’autant plus inévitable.
J’ai passé deux années et demi avec Salgado. Il est sympa. Enfin, quand il rentre dans le noir avec toi et qu’il te regarde faire les tirages, il n’est pas vraiment sympa (rires), mais c’est quelqu’un de très bien. Chez Amazonas, l’agence dédiée au travail de Sebastião Salgado, il y avait des négatifs partout. Il suffisait de fouiller un peu pour tomber sur des choses incroyables. J’étais là au début du projet Genesis, et j’avais accès à tout ce qu’il avait fait avant : La Main de l’Homme, le Sahel… Des vraies masterpieces.
En général, il partait pour un mois de reportage avec 300 pellicules de 30 vues chacune. On était deux à s’en occuper. Avec un volume pareil, il n’y a pas meilleure école de tirage. Et puis c’est stimulant, parce qu’il ne fait pas de demande particulière. Son état d’esprit du moment te dicte ce que tu dois faire. Même si c’est surexposé de deux diaphragmes dans le ciel, il faut qu’il ait toutes les informations au moment où tu lui présentes son tirage de lecture, pour éventuellement pouvoir dire après : “C’est pas mal comme ça, mais il va falloir fermer beaucoup plus le ciel”.
Qu’est-ce que tu ressens quand tu développes d’éventuels futurs chefs-d’œuvre de la photographie ?
Ce qui est très intéressant, c’est de découvrir le chemin que le photographe a emprunté pour arriver à un bon résultat. Salgado n’entrait pas dans une hutte au fin fond du Sud-Soudan pour prendre une photo et s’en aller. Il tournait autour, il observait, il entrait, la lumière changeait… C’est ce parcours qui est intéressant. Parfois, tu te dis : “Je pense qu’il va prendre celle-là”, parce que tu sens que quelque chose se passe, mais tu le gardes pour toi. Il n’y a pas vraiment ce sentiment de privilège de l’avoir vu avant tout le monde. Tu apprends, tout simplement.
Tu montes ton atelier en 2008, 2 ans après que Nikon, Canon et Konica Minolta avaient annoncé qu’ils abandonnaient la production d’appareils de photo argentique, au profit du numérique. Qu’est-ce que cela a voulu dire pour toi ?
En sortant de chez Salgado, je voulais voir autre chose. En deux ans et demi, je n’avais pris aucune photo pour moi. Il y a un vrai trou dans ma photographie à ce moment-là. Un ami m’a proposé de prendre un espace dans un squat à Vitry. C’est là que j’ai commencé à faire du tirage pour le “grand” public.
La crise qui allait arriver ne m’a pas angoissé plus que ça. Parce que je suis têtu, que j’aime ce que je fais et que rien n’aurait pu m’empêcher de le faire. Bien sûr, la demande a baissé. Mais j’ai développé ce labo en sachant que ce serait compliqué, qu’à un moment donné ça se jouerait à trois clients et qu’il ne faudrait pas les lâcher. C’est aussi pour ça que j’ai élargi mon offre à une clientèle parfois amateure, sans me cantonner aux anciens de chez Picto. Aujourd’hui, pour tout dire, ce labo ne me permet toujours pas de gagner ma vie. Disons que le choix du cœur n’a tout simplement pas été celui de la simplicité.
Quoi qu’il arrive, tu tiens à rencontrer chacun de tes clients, pour “créer un lien” avec eux.
Rencontrer les gens, c’est la base de mon métier. Si les gens viennent poser des films, qu’ils s’en vont et qu’il n’y a pas eu d’échange, ça ne m’intéresse pas. Et en plus, dans ce cas là, mon métier n’est pas reconnu. Je suis fier de ce que j’ai appris en CAP et plus tard à travers mes différentes expériences. Même si avec le temps ça tend à devenir un hobby, quand j’ai commencé, tireur photo était un vrai métier (rires). C’est important que les gens le sachent.
Tu n’as jamais été particulièrement studieux, et pourtant il y a dans le développement et le tirage un aspect très mathématique.
Je ne trouve pas que ce soit “mathématique”. C’est juste de la photo, et les variations de lumière qui vont avec. Il faut simplement savoir quantifier la dose de lumière que tu dois ajouter à un tirage pour qu’il soit plus ou moins sombre. C’est un instinct que tu finis par attraper. Tout ce que j’ai appris au développement avec les quarts et les demi diaphragmes, ça me permet de savoir précisément ce qu’il faut faire quand je suis devant un tirage.
Tous les jours, tu révèles les images les plus intimes de personnes que tu ne connaissais pas quelques heures auparavant. Est-ce que tu y perçois une dimension voyeuriste ?
Pas vraiment, non. Je vois passer des clichés particuliers de temps en temps, bien sûr, mais je les vois sans les voir. Quand un de mes clients me demande de développer une série qu’il a faite de son amie, je regarde le film : “Il est bien exposé ? C’est parfait.” Je lui montre la planche contact et c’est terminé. Après, évidemment si tu me dis que tu es parti à l’autre bout du monde photographier un sujet qui me parle particulièrement, une compétition de skate ou de surf par exemple, je vais jeter un œil gentiment.
Tu te sens proche de la culture surf ?
Oui. J’adorerais en faire des photos avec ma chambre photographique par exemple. Pas des athlètes en train de faire des figures incroyables dans des creux de deux mètres, mais plutôt des backstages. Chris Burkard fait ça super bien, à la chambre ou avec d’autres boîtiers. J’aime bien cet esprit. Ce sont les coulisses qui m’intéressent, les gens qui gravitent autour de ces sports. Entre la préparation, les voyages et la compétition, il y a largement de quoi faire. Tous les étés, je me dis que je vais me payer des vacances pour aller revoir tout ça.
De manière générale, il y a des clichés que tu préfères tirer ?
J’adore les reportages, les paysages. C’est ce que je préfère tirer parce que ça me parle. Les photos de mode, leurs artifices et leurs compositions ultra précises, c’est moins mon truc. Par définition, il y a ce côté “vrai” dans les clichés de reportage que tu ne retrouveras pas ailleurs. Attention, j’aime qu’il y ait une recherche graphique dans la composition, mais sans exagérer la démarche.
On imagine le travail de tireur comme celui d’un solitaire, “terré” dans son atelier. Tu as besoin de cette solitude pour travailler ?
Oui. C’est une activité où l’on se sent bien seul. Seul, dans l’ambiance du photographe avec lequel on travaille. Ça permet de se confronter à la tâche que l’on doit effectuer. Certains tireurs ne peuvent pas travailler sans musique. Personnellement, je préfère le silence complet, on peut entendre les mouches voler. Je travaille lentement, précisément, je suis dans mon truc et tout s’enchaîne. Dans la photographie, c’est pareil. J’ai vraiment besoin de cette solitude pour me concentrer sur mon sujet. Je crois que c’est un ingrédient essentiel à l’exercice de la photographie de manière générale.
Surtout quand on réalise l’importance de l’acte de développement et la dimension symbolique qui se cache derrière.
Complètement. C’est l’aboutissement de ce qu’a voulu le photographe. Si il est parti à tel endroit, qu’il y a passé une heure, quinze jours ou des années et qu’il y a fait telle photo, c’est très important, depuis le négatif jusqu’au tirage, de penser au moment où il a déclenché son appareil. En prenant la photo, il savait ce qu’il chercherait à exprimer en faisant appel à tes services. Si tu réussis à matérialiser cette idée, c’est bingo. C’est pour cette raison que l’histoire dure souvent très longtemps entre un photographe et un tireur qui se comprennent.
Le fait que le processus de développement ne soit pas instantané est très important aussi. Quand je reviens de voyage et que je développe mes films, je sélectionne, je tire en petit et, seulement quand je suis convaincu, je tire en plus grand. Il y a toute une phase de réflexion qui amène le recul nécessaire à un bon résultat.
Il y a 30 ans, aucune photo ne pouvait être contemplée sans être passée par un bain révélateur. Aujourd’hui, 99% d’entre elles apparaissent instantanément sur écran digital. Qu’est-ce que cela signifie à ton sens pour la photographie ?
Le problème, c’est que les gens ne font plus attention. C’est aussi simple que ça. Aujourd’hui, l’appareil photo est devenu un gros boîtier Polaroïd. Tu ne fais même plus ta mesure. “C’est surexposé ? C’est sous-exposé ? C’est ce que je veux.” À aucun moment tu n’as pris la lumière en considération. Nous sommes dans une dynamique de consommation excessive de la photographie. Les gens font des clichés mais ne les regardent pas. En argentique, quand on a un sujet ou qu’on identifie tout simplement quelque chose dans la rue qui semble valoir le coup, il faut tourner autour, en faire cinq, dix pour être sûr d’obtenir un résultat. Avec le numérique, les photographes mitraillent et vérifient leur cadre ensuite.
J’ai remarqué quelque chose avec mes élèves (Atelier photo, Paris III). Si je leur donne un smartphone ou un numérique, ils sont capables de faire 500 images en une soirée. Avec un Lomography classique, ils ont du mal à terminer une pellicule en une semaine. C’est très contradictoire. Pour apprendre la photographie, il faut photographier. Même si le prix de l’argentique joue beaucoup, bien sûr. En réduisant les coûts, le numérique a permis de démocratiser une pratique qu’il a aussi transformée, pas toujours dans le bon sens.
Et toi, quels sont les appareils que tu affectionnes particulièrement ?
Quand je prends une photo, je ne veux pas me poser trop de questions. Leica, chambre, Mamiya… Ce ne sont que des outils. Si je devais en choisir un absolument, ce serait le Leica M6. C’est un modèle qui me correspond bien : un boîtier, l’ouverture, les vitesses et la sensibilité du film. L’avancement est manuel, il n’y a rien de plus simple. C’est comme mon agrandisseur : quand il se casse, je sais comment le réparer. Plus qu’un matériel photographique, c’est un outil mécanique que je répare. Le M6 c’est pareil : costaud, pas tape-à-l’œil, pratique parce qu’il y a une cellule à
l’intérieur… Et ça fonctionne super bien. À côté de mes boîtiers, je n’ai pas que des optiques hors-de-prix. J’ai chiné quelques modèles russes qui me conviennent tout à fait, et faire des photos avec un 24 mm tout rayé ne m’a jamais posé aucun problème. Ce n’est pas le matériel qui fait le photographe.
Tu entretiens un rapport particulier avec la lumière ?
La lumière est partout dans mon quotidien. Je regarde toujours par la fenêtre pour inspecter la manière dont elle inonde la rue, identifier la façon dont les nuages jouent sur son éclat, pour retrouver le même rendu lors d’un tirage futur. Il y a une vraie différence entre voir et regarder. Je regarde toujours la lumière. C’est elle qui me fait travailler donc elle est omniprésente. Hier, je rentrais chez moi, il pleuvait, la lumière était rasante, c’était complètement dingue. Je n’aime pas les lumières trop plates. Aujourd’hui, ce que nous avons dehors par exemple (jour blanc), ça me fait mal aux yeux.
Thématiques
INSTAGRAM — Rejoignez la plus grande communauté de nouveaux aventuriers