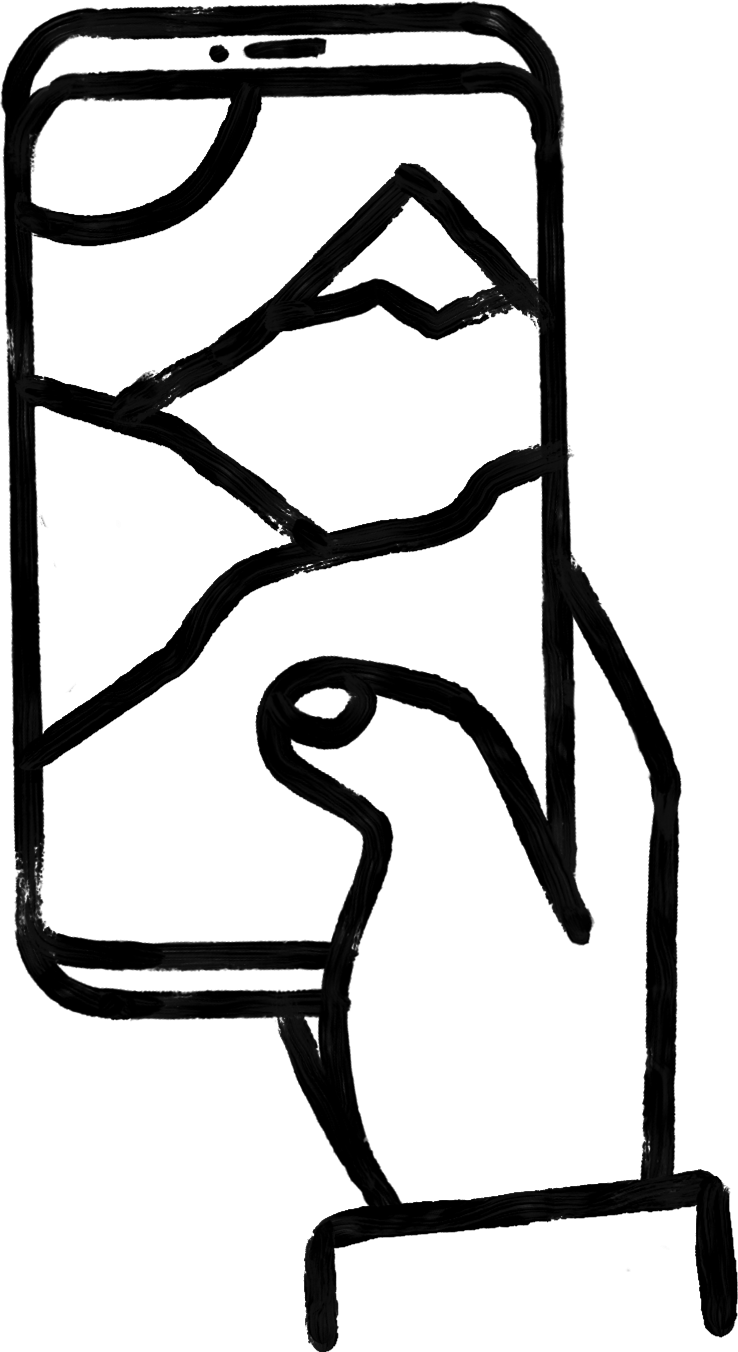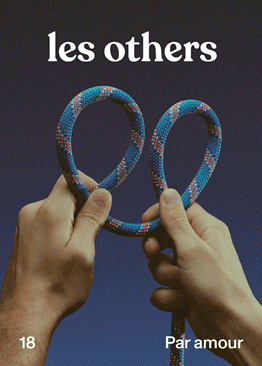L’aventure est parfois périlleuse. Thibault, Quentin, Maxime, Pascal et Benjamin en ont fait l’expérience en embarquant à bord d’un voilier dans les eaux de Patagonie. Un seul objectif : le cap Horn, ce bout du monde où deux océans se rencontrent.
Jour noir
Puerto William, 7 heures du matin. Je m’empresse de rejoindre le bord pour communiquer à l’aide du faible wifi de la capitainerie. L’endroit a des airs de bateau fantôme pirate, chaque recoin est chargé d’histoires légendaires. Les plus grands navigateurs sont passés ici, dans ce petit village au bout du monde.
Le lieu où nous sommes s’appelle la fin du monde. On se sent étrangement bien le plus loin possible des hommes. Même ce minuscule village est un dernier rempart. Vivement la mer. Après plusieurs verres de vin, nous décidons de partir de nuit car le temps s’annonce favorable. Loin des hommes, les communications sont coupées et l’absence est lourde.
La tempête
Réveil en pleine tempête, j’aperçois dans l’entrouverture notre capitaine dans la tourmente. J’hésite à bouger de ma banquette, j’ai la vessie remplie et le moindre mouvement risque d’engendrer un violent mal de mer. Aller pisser dehors avec cinquante noeuds de vent est impossible, je ne vais pas risquer ma vie.
Je vais devoir aller à l’intérieur à l’avant de la cabine, la où ça gîte le plus. J’agis prudemment pour ne pas m’en foutre partout et ne pas avoir immédiatement envie de vomir. La mer nous secoue de plus en plus, c’est une tempête. J’y vais, je ne peux plus tenir. Je sors sur le pont un peu frêle. Un vent violent me gifle le visage, des trombes d’eau défient mon équilibre, c’est bizarrement excitant. Benji, notre ami vosgien, est en plein délire : chaque embrun provoque chez lui un rire fou. Bientôt l’accalmie.
Terre de désolation
Ici tout est plus simple, le temps s’étend, les secondes se dilatent. Chaque produit a plus de valeur. Nous nous sommes réfugiés près d’une crique abritée du vent. Le sable est jonché de moules, non comestibles en raison d’une contamination, mais dont nous pouvons toutefois nous servir pour appâter des poissons. Il n’y a pas grand choses à pêcher non plus, les gros poissons évoluent en eaux profondes. Quelques petits pêchés à la ligne suffiront néanmoins à attirer les crabes « santochas » dans nos casiers. En prenant le temps, tout devient plus savoureux.
Nous évoluons dans un monde hostile, les charognards deviennent nos proies, des morceaux de glaciers menacent la coque de notre navire. Se réfugier sur les terres humides de Patagonie nous laisserait peu d’espoir. J’ai rencontré un marin quelques jours plus tôt, en proie à de la tachycardie. Malgré des dizaines d’années d’expérience en mer, il décida de rentrer plus tôt, n’étant plus en confiance. Le moindre pépin peut effectivement prendre beaucoup d’ampleur. Ici on ne peut compter que sur soi et ses compagnons de route. Chaque instant prend plus de relief.
Emma et Christophe
Nous rencontrons un autre bateau. Une quinzaine de voiliers proposent des navigations dans les glaciers ou le passage du cap Horn pour 250 euros par jour. Emma et Christophe sont de ceux-là. Christophe me raconte ses années passées sur l’eau à faire le tour du monde avec son père. Emma, elle, nous amène dans des sentiers qu’elle seule connaît pour grimper au sommet des montagnes et être submergé par la beauté de l’endroit.
Je n’avais jamais vu de paysage aussi époustouflant. À chaque fois, les quelques heures de marche dans la boue en valent le coup. Ce couple est inspirant, ils ont choisi une vie d’aventures. Nos réflexes citadins leur semblent sans doute absurdes. Choisir de vivre pleinement, de ne pas attendre de ne plus pouvoir le faire pour se trouver des excuses. Tout simplement, plus près des étoiles et de l’océan.
Trente ans entre amis
Minuit sur le pont au creux d’une calebasse. Le ciel est dégagé, on aperçoit les étoiles. Les cales se vident rapidement en pinard, on doit se rationner. Du coup, on s’est rabattus sur une vieille mirabelle qui nous frappe le sang. Par chance, Quentin a retrouvé un reste de weed dans la poche d’un de ses jeans. On devient vaporeux dans le clair de lune. Benji nous parle d’une sorte de père spirituel ésotérique.
« Les gars, j’ai un truc important à vous dire mais promettez-moi d’en parler à personne ». Pascal retient notre attention. « Vas y balance, crache le morceau ». J’ai l’impression d’être dans un film de Guillaume Canet, des amis trentenaires éméchés se remettant en question sur un voilier. Parfois, les clichés sont très agréables à vivre. « Les gars, c’est pas encore sûr donc n’en parlez à personne mais je vais être papa ».
Vivre de peu et être heureux est sans doute la plus grande leçon qu’offre un séjour sur les eaux du bout du monde. Ici on ressent simplement le besoin de se nourrir, d’aimer, de découvrir et de chanter. Vivre plus lentement permet de retrouver la valeur de chaque chose. Si je pétris bien le pain le soir, mon petit déjeuner sera savoureux. Si je pose des casiers la nuit, je pourrais chanter en décortiquant des santochas le lendemain et déguster leur chair à l’apéro. Si je hisse la grande voile, je pourrais avancer sans bruit aux confins du monde et enrichir mon chemin.
Le bruit des glaçons
Le glacier de Garibaldi nous fait face. Nous décidons de nous en approcher en Kayak. On entend la glace se fissurer. Le tonnerre retentit et d’énormes bouts de glaces s’effondrent dans l’eau, provoquant de longues vagues. Nous restons muets face à l’impériosité du moment. La glace s’éparpille dans l’eau et envahit par constellation l’embouchure du canal. J’ai rarement vu quelque chose de si beau.
Un vent chaud du nord réchauffe l’endroit alors que le glacier s’émiette dans l’eau. Je ne peux m’empêcher de penser à l’ère de glace, le big freeze qui est annoncé dans quelques milliards d’années. Peu à peu, le climat va s’homogénéiser partout dans le monde, le rayonnement s’affaiblira graduellement en raison de l’expansion éternelle de l’univers qui deviendra alors un immense cimetière glacé, majestueux, sombre et funeste.
La conquête
Conquête d’un îlot à la gloire d’un royaume imaginaire. Constituer un nouvel état semble impossible. Pourtant certains se le permettent et s’auto-proclament à la tête d’une nouvelle nation, avec un nouvel étendard. Démarrer à partir d’une page vierge a quelque chose de terriblement excitant. Pourquoi ceux qui s’offrent cette liberté l’utilisent souvent au service du pire ?
Ici en Patagonie, un roi s’est autoproclamé. Nous décidons de le rejoindre et de partir à la conquête d’un îlot pour poser l’étendard patagon. Nous ne souhaitons aucune règle, un vent de liberté soufflera sur cette île que nous attaquons fièrement au petit matin bouteille de jaja à la main. L’île fait une trentaine de mètres de diamètre, juste de quoi nous accueillir. Ce lieu sera désormais à nous, une parenthèse enchantée loin de la réalité. Quelque part au bout du monde, ici, sur cette îlot refuge, personne ne doit nous dire comment nous comporter.
Une baleine
L’horizon se dégage, au loin le Pacifique. L’eau a toujours quelque chose de plus impressionnant sur les océans. Le temps est gris et froid, une pluie glacée gèle le bateau. Au loin, la queue d’une baleine sort de l’eau. Nous tentons de nous en approcher doucement. Elle reste à une bonne distance de notre bateau.
L’animal plonge dans les eaux noires du Pacifique. Nous sommes tous muets sur le pont dans l’espoir de la voir de plus près. Nous sommes les seuls humains à des kilomètres à la ronde, le seul mammifère qui nous accompagne, c’est cette baleine. Les baleines possèdent sans doute des secrets sur les abysses. En rencontrer une a quelque chose de mystique.
Escale à Puerto William
Finalement, sans communication, loin des autres, la vie est tout de même plus simple. Nous arrivons à quai, désormais je ne suis intéressé plus que par mon téléphone qui me reconnecte à mon petit monde. Je me sens con. Nous reprenons la mer après une soirée très arrosée dans l’unique bar de Puerto William. La gueule de bois me fragilise, je ressens pour la première fois le mal de mer. Je reste avachi sur une des banquettes de la cabine pendant de longues heures. Le bateau se balade comme un bouchon de liège sur l’océan, chamboulé par l’immensité. Mon esprit divague, je tombe épuisé dans un demi sommeil. Je suis désormais à la barre d’un navire plus gros que le nôtre, j’affronte des creux de dix mètres en surfant sur les vagues. À ma droite, j’aperçois un cimetière de baleine avec des carcasses et des dizaines de rorquals se laissant mourir. L’eau est turquoise, claire et très saturée.
Nous sommes en route vers le cap Horn. Le vent est avec nous pour l’instant. Le soir, nous nous arrêtons dans la dernière maison avant l’immensité vide et glacée. Un militaire vit ici avec sa famille pour venir en aide aux marins et donner la météo. La petite famille est complètement isolée du reste du monde avec un pingouin en guise d’animal de compagnie. La télévision est leur seule fenêtre sur le monde. L’isolement total dans une nature brutale et sans concession. Ils nous racontent leur difficulté à manger des légumes, à maintenir une alimentation équilibrée pour leurs deux petites filles. Ils évoquent également ces jours de tempête sans télévision, ni électricité. Une vie au milieu des paniers de crabes avec pour seules visites quelques pêcheurs aux visages burinés par le sel et le vent. Comment ne pas devenir fou ?
Le cap Horn
Après une journée calme sur l’île d’Hermine à quelques miles du cap, nous partons au petit matin pour le passage légendaire, à l’endroit où le Pacifique rencontre l’Atlantique, où ils expriment toute leur violence sur des hauts fonds. La matinée est grise et venteuse, un temps peu rassurant pour s’engager dans un passage à la réputation si terrible. Nous nous rapprochons de la pointe du Horn, la houle gonfle et le vent s’intensifie. Nous réduisons la voilure pour ne pas se faire coucher et engloutir.
En bordant la grande voile, une drisse se bloque. La situation est délicate, les vagues sont désormais menaçantes et nous giflent la gueule, chaque mouvement doit être fermement assuré pour ne pas se faire éjecter du bateau. Le capitaine hurle ses ordres pour se faire entendre malgré le vent et l’entrechoquement des cordages.
La situation se débloque heureusement, la grande voile finit par tomber, nous avançons désormais à huit noeuds juste en surfant sur les vagues. Quentin me fait signe : « Putain mec regarde derrière nous ». Des montagnes d’eau s’élèvent à la proue. Le bateau se fait secouer comme une coquille de noix. L’ambiance au sein du bateau change. Si le temps ne s’améliore pas, la journée va être très longue. Si la mer ne se calme pas, je n’ose pas y penser.
Des rafales de vent à quarante noeuds nous propulsent dans le creux des vagues. Pourquoi suis-je allé me foutre dans un merdier pareil. Nous nous rapprochons du Horn, la houle se réduit, le sourire revient sur le visage du capitaine. Nous sommes à l’abri du danger pour le moment. Le passage de Nassau, sur le retour, est également exposé au Pacifique. Nous consultons la météo pour savoir comment le reste de la journée va se dérouler. Heureusement, les prévisions sont bonnes. Le vent doit tomber à 20 noeuds et il s’annonce de travers.
Retour au calme
Nous rentrons sur une mer plus accueillante. On a évité le pire, le bateau a tenu dans une mer dégueulasse, impétueuse, prête à nous ensevelir. Notre bateau, ce vieux héros de cinquante ans à la coque chargée d’histoires de mers, d’émotions de vies, de frissons. Lorsque nous nous sommes engagés à venir ici, on espérait secrètement être secoués pour revenir avec de belles histoires à raconter. Mais à ce point, putain !
Le soleil se couche sur une mer d’huile, nous amarrons à Puerto del Torro, le village le plus austral au monde. Des pêcheurs nous accueillent les mains remplies de santochas et de poulpes. Nous troquons un mollusque contre quelques canettes de bières et des clopes. Le soir, nous buvons beaucoup pour fêter le simple fait d’être en vie. Je sors dehors fumer une cigarette sous un ciel illuminé par les constellations. Je me couche avant les autres, pressé de rejoindre Puerto Williams. Je suis heureux de vivre.
Retrouvez la vidéo de l’aventure ci-dessous.
Un immense merci à Jeanne et Bernard de Ravignan.
Thématiques
INSTAGRAM — Rejoignez la plus grande communauté de nouveaux aventuriers